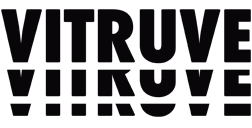19 de août de 2025
Vitesse Moyenne Vs Vitesse Moyenne Propulsive. Différences et Applications
L’efficacité de l’entraînement en résistance (RT) pour atteindre des objectifs spécifiques dépend de la manipulation appropriée de diverses variables qui influencent de manière significative à la fois les réponses aiguës et les adaptations physiologiques ultérieures (Bird et al., 2005; Kraemer et al., 2002; Spiering et al., 2008). La prescription de l’entraînement doit prendre en compte chaque variable en fonction de l’objectif recherché, l’intensité de l’exercice étant un facteur clé influençant les adaptations neuromusculaires (Fry, 2004; Bird et al., 2005).
Dans ce contexte, l’entraînement basé sur la vitesse (VBT) apparaît comme une méthode efficace pour ajuster avec précision l’intensité de l’entraînement au quotidien. Cette approche trouve son origine dans l’étude pionnière de González-Badillo et Sánchez-Medina (2010), qui a établi une relation entre le pourcentage de charge relative (%1RM) au développé couché et la vitesse moyenne propulsive (MPV), démontrant une valeur de R² de 0,98. Cette découverte permet à la vitesse de levée de servir d’indicateur de l’intensité relative, éliminant ainsi la nécessité de tests de 1RM ou xRM. Des recherches ultérieures ont exploré cette relation dans divers exercices, notamment les squats complets (Sánchez-Medina et al., 2017), les tractions pronation (Sánchez-Moreno et al., 2017), tout en identifiant des différences entre les sexes afin d’améliorer le contrôle et l’individualisation (Pareja-Blanco, Walker, et al., 2020). Ainsi, en mesurant la MPV, le %1RM peut être automatiquement déterminé.
Cependant, d’autres études suggèrent que mesurer cette relation en utilisant la vitesse moyenne (MV) offre une plus grande précision pour les équations de régression générales prédisant la charge relative (%1RM) à partir de la vitesse de mouvement que la MPV (García-Ramos et al., 2018). Ce sujet a suscité une controverse considérable dans les milieux scientifiques et professionnels. À cet égard, le texte qui suit abordera cette question et invitera à réfléchir sur la variable la plus appropriée pour quantifier l’intensité dans diverses situations et contextes.

Importance de la Phase Propulsive
Pour déterminer quelle vitesse doit être utilisée pour prédire la charge relative (%1RM) ou pour détecter des changements de performance dus à une augmentation de la vitesse d’exécution contre une charge absolue quelconque, il faut d’abord examiner l’étude de Sánchez-Medina et al. (2010).
Les résultats de cette étude indiquent que se référer exclusivement aux valeurs de vitesse moyenne de la phase propulsive (MPV) lors de l’évaluation de la vitesse et de la puissance avec lesquelles une charge est soulevée pendant une action concentrique permet d’éviter de sous-estimer la capacité neuromusculaire d’un individu, en particulier lors du soulèvement de charges légères et modérées. En ce sens, la phase propulsive est définie comme la portion de la phase concentrique durant laquelle l’accélération (a) dépasse l’accélération gravitationnelle (c’est-à-dire, a ≥ -9,81 m∙s⁻²).
Pour mieux comprendre ces conclusions de manière claire et pratique, observons les figures suivantes :
Figure 1. Phase concentrique d’une répétition avec 20% de 1RM dans l’exercice du développé couché
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Figure 2. Phase concentrique d’une répétition avec 20 kg (15,7% de 1RM) dans l’exercice du développé couché
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Tout d’abord, il est essentiel de distinguer entre la phase d’accélération, la phase de décélération, la phase propulsive et la phase de freinage lors d’une répétition concentrique d’un exercice spécifique, dans ce cas le développé couché, tel qu’utilisé dans l’étude de Sánchez-Medina et al. (2010). Dans cet exercice, le mouvement commence à une vitesse de zéro lorsque la barre repose sur la poitrine, puis atteint une vitesse maximale pendant la partie concentrique, et revient à zéro lorsque les coudes sont complètement tendus et que la barre est immobile, indiquant que la phase concentrique de cette répétition est terminée. Ce comportement de la vitesse peut être illustré dans les Figures 1A et 1B à 20% de 1RM (points en pointillés) et dans la Figure 2 à 15,7% de 1RM lors du développé couché (ligne bleue).
Un aspect critique lors du soulèvement de charges dans des exercices isoinertiels typiques à vitesse maximale intentionnelle est qu’une partie importante de la phase concentrique est consacrée à décélérer la résistance en mouvement. Pour observer cela, il faut d’abord comprendre que la force (F) se calcule comme F = m · (a + g), où m est la masse en mouvement (kg) et g est l’accélération due à la gravité. La production de puissance est le produit de la force verticale appliquée et de la vitesse de la barre (P = F · v). À cet égard, nous pouvons observer une phase d’accélération représentant 70% de la phase concentrique à 20% de 1RM (Figure 1B). Cette phase d’accélération correspond à la portion de la phase concentrique où l’accélération est supérieure à 0 m∙s⁻². Cela indique la phase où la force appliquée est supérieure au poids soulevé (en faveur du mouvement). Cette phase se poursuit jusqu’à ce que la vitesse maximale soit atteinte. En revanche, la phase de décélération représente 30% de la phase concentrique à 20% de 1RM (Figure 1B), correspondant à la portion où l’accélération est inférieure à 0 m∙s⁻². Cela signifie que la force appliquée est égale ou inférieure au poids soulevé (contre le mouvement).
En considérant que la phase d’accélération dure jusqu’à l’atteinte de la vitesse maximale, nous pouvons observer dans les Figures 1A, 1B et 2 qu’à ce point de vitesse maximale, il y a encore de la puissance (Figures 1A et 1B) et une application de force (Figure 2), indiquant que les valeurs de force, et par conséquent de puissance, restent supérieures à 0. Cela implique que la phase propulsive dure un peu plus longtemps que la phase d’accélération, puisqu’elle est définie comme la portion de la phase concentrique durant laquelle l’accélération est supérieure à -9,81 m∙s⁻² (l’accélération due à la gravité). Par conséquent, la phase propulsive engloberait la phase d’accélération, où plus de force est appliquée que ce que représente la charge, ainsi que la portion où l’accélération passe de 0 à moins de -9,81 m∙s⁻², ce qui correspond à la phase où la force est égale au poids soulevé. Ainsi, tandis que la phase d’accélération dans la Figure 1B représente 70%, la phase propulsive serait de 76,7% (Figure 1A). Le pourcentage restant correspond à la phase de freinage, durant laquelle l’accélération est inférieure à -9,81 m∙s⁻², et donc l’application de la force s’oppose au mouvement, même si la barre continue de se déplacer jusqu’à la fin de la répétition (Figure 2). Ce mouvement se produit inconsciemment pour éviter que la barre ne soit projetée.
En résumé, si nous obtenons la VM (vitesse moyenne) d’une répétition de développé couché, la vitesse correspondrait à la moyenne de toutes les valeurs de vitesse durant l’exécution. Cependant, la VMP (vitesse moyenne propulsive) serait la moyenne de toutes les valeurs de vitesse du début à la fin de la phase propulsive.
Différences entre vitesse moyenne et vitesse moyenne propulsive
Une fois que nous avons compris la phase d’accélération, la phase de décélération, la phase propulsive et la phase de freinage, nous pouvons examiner comment ces phases influencent une action concentrique sous différentes charges.
Dans ce contexte, il a été démontré que la phase de freinage est plus importante lorsque la charge est plus légère. Cela s’explique par le fait que les charges légères permettent d’atteindre des vitesses plus élevées, ce qui conduit à une phase de freinage plus marquée (Figure 3).
Figure 3. Contribution relative des phases propulsive et de freinage à la durée totale de la phase concentrique lors de l’exercice du développé couché
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
À titre d’exemple pratique, nous pouvons nous référer à la Figure 4, qui illustre deux phases concentriques : l’une avec une charge légère (20% 1RM) et l’autre avec une charge lourde (80% 1RM). Dans cette figure, nous pouvons observer que la Puissance Moyenne (PM) pour la charge de 20% 1RM était de 256 W, tandis que la Puissance Moyenne Propulsive (PMP) était de 422 W. Cela indique que la PM sur l’ensemble de la phase concentrique était inférieure de 40% à la PMP de la seule phase propulsive.
Figure 4. Phase concentrique d’une répétition avec 20% 1RM et une avec 80% 1RM dans l’exercice du développé couché.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
En revanche, ces différences entre PM et PMP n’existaient pas lorsque la charge était à 80% 1RM, où les deux valeurs étaient de 318 W. Cela suggère que l’écart entre ces paramètres diminue progressivement à mesure que les charges soulevées deviennent plus lourdes, jusqu’à atteindre un point où la phase de freinage disparaît et où les deux paramètres convergent.
Plus précisément, dans l’exercice du développé couché, il a été observé que la charge à laquelle la phase de freinage cessait d’exister était de 76,1 ± 7,4% 1RM, et que la vitesse à laquelle la phase de freinage n’existait plus était de 0,53 ± 0,07 m∙s⁻¹ (Figure 5).
Figure 5. Relation entre la contribution de la phase propulsive à la durée concentrique totale de la levée et la charge (%1RM) (A) ; et la vitesse moyenne propulsive et la contribution de la phase propulsive (B) dans l’exercice du développé couché.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
En résumé, selon l’étude de Sanchez-Medina (2010), lors du soulèvement de charges légères et modérées, il existe une phase finale durant laquelle la décélération est d’une ampleur supérieure à ce que l’on pourrait attendre uniquement en raison de l’effet de la gravité. Cela résulte du fait que l’athlète applique une force dans la direction opposée au mouvement de la charge.
Applications de la vitesse moyenne et de la vitesse moyenne propulsive
Une fois la définition clarifiée, examinons un exemple pratique de la manière dont le choix de la vitesse peut influencer l’observation des changements de performance dans un exercice spécifique.
Dans la Figure 6, nous pouvons observer un test incrémental réel de charges progressives dans l’exercice du squat, qui fournit des informations sur les changements de performance avec des charges légères, modérées et lourdes.
Figure 6. Changements dans la performance du squat (VMP et VM) après un programme d’entraînement en résistance.
À partir des lignes continues de cette image, nous pouvons conclure que l’athlète s’est amélioré, car il est capable de soulever chaque charge à une vitesse plus élevée (de 20 à 100 kg par incréments de 10 kg).
De plus, nous pouvons distinguer entre VMP et VM (ligne continue vs. ligne pointillée). Lorsque les charges sont lourdes, les vitesses sont assez similaires ; cependant, avec des charges plus légères, de plus grandes différences apparaissent entre VMP et VM. Cette observation confirme la discussion abordée précédemment sur la phase propulsive sous différentes charges.
Il est à noter que la figure met en évidence que les changements de performance avant et après l’entraînement sont plus marqués lorsqu’on compare la VMP que lorsqu’on compare la VM. De plus, si l’on examine la charge de 70 kg, on observe que lors du pré-test, les différences entre VMP et VM étaient minimes, tandis que dans le post-test cette différence augmente. Cela s’explique par le fait que lors du pré-test, la charge n’était pas suffisamment faible pour permettre un mouvement à grande vitesse et une phase de freinage plus longue. En revanche, lors du post-test, l’athlète s’est amélioré et la charge absolue de 70 kg représente une intensité relative plus faible, permettant une vitesse de mouvement plus élevée et la présence d’une phase de freinage.
En résumé, l’utilisation de la VM offre une sensibilité moindre que la VMP pour détecter les changements de performance. Par conséquent, si je veux réellement comprendre les changements de performance de mon athlète, notamment avec des charges légères, je dois choisir de mesurer la VMP. En revanche, la VM reste une option valable lorsqu’on observe des changements avec des charges plus lourdes (où il n’y a pas de phase de freinage) ou lorsqu’aucun dispositif pour mesurer la VMP n’est disponible.
RÉFÉRENCES
Bird, S. P., Tarpenning, K. M., & Marino, F. E. (2005). Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness: a review of the acute program variables. Sports Med, 35(10), 841-851.
Fry, A. C. (2004). The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Med, 34(10), 663-679.
García-Ramos A, Pestaña-Melero FL, Pérez-Castilla A, Rojas FJ, Gregory Haff G. Mean Velocity vs. Mean Propulsive Velocity vs. Peak Velocity: Which Variable Determines Bench Press Relative Load With Higher Reliability? J Strength Cond Res. 2018 May;32(5):1273-1279.
Gonzalez-Badillo, J. J., & Sanchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. Int J Sports Med, 31(5), 347-352.
Kraemer, W. J., Ratamess, N. A., & French, D. N. (2002). Resistance training for health and performance. Curr Sports Med Rep, 1(3), 165-171.
Martinez-Cava, A., Moran-Navarro, R., Sanchez-Medina, L., Gonzalez-Badillo, J. J., & Pallares, J. G. (2019). Velocity- and power-load relationships in the half, parallel and full back squat. J Sports Sci, 37(10), 1088-1096.
Pareja-Blanco, F., Walker, S., & Häkkinen, K. (2020d). Validity of using velocity to estimate intensity in resistance exercises in men and women. Int J Sports Med , 41(14), 1047-1055.
Rodriguez-Rosell, D., Yanez-Garcia, J. M., Sanchez-Medina, L., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2020). Relationship Between Velocity Loss and Repetitions in Reserve in the Bench Press and Back Squat Exercises. J Strength Cond Res, 34(9), 2537-2547.
Sanchez-Medina, L., Perez, C. E., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2010). Importance of the propulsive phase in strength assessment. Int J Sports Med, 31(2), 123-129.
Sanchez-Medina, L., Pallares, J. G., Perez, C. E., Moran-Navarro, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise. Sports Med Int Open, 1(2), E80-E88. https://doi.org/10.1055/s-0043-102933 (Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise.)
Sanchez-Moreno, M., Rodriguez-Rosell, D., Pareja-Blanco, F., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Movement Velocity as Indicator of Relative Intensity and Level of Effort Attained During the Set in Pull-Up Exercise. Int J Sports Physiol Perform, 12(10), 1378-1384. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0791
Spiering, B. A., Kraemer, W. J., Anderson, J. M., Armstrong, L. E., Nindl, B. C., Volek, J. S., & Maresh, C. M. (2008). Resistance exercise biology: manipulation of resistance exercise programme variables determines the responses of cellular and molecular signaling pathways. Sports Med, 38(7), 527-540.