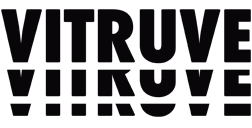18 de août de 2025
Créer un programme de force et de conditionnement pour la période hors saison et en saison
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait la réussite d’un athlète ? Tout comme Einstein a décrit la nature de l’univers avec la formule de la relativité E=mc², nous pouvons décrire la performance humaine avec une formule simple : Performance = Puissance / Coût énergétique. La performance physique est donc le rapport optimal entre la puissance et le coût énergétique, deux éléments qui dépendent tous deux de la force maximale. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le moment et la manière d’entraîner la force maximale et la puissance.
L’importance de la périodisation
La périodisation se compose de deux processus à la fois liés et distincts :
- Planification : définir les objectifs principaux en fonction de l’importance des événements.
- Programmation : établir la méthode et les moyens d’entraînement, la charge et les périodes d’allègement.
La périodisation est essentielle pour préparer un athlète aux compétitions sportives !
Une fois le calendrier des compétitions établi, il est crucial d’introduire les différents éléments de l’entraînement au bon moment, en utilisant des méthodes et des outils validés scientifiquement, tels que l’entraînement basé sur la vitesse (VBT) et un codeur linéaire comme Vitruve. Des études ont montré que la vitesse associée à un certain pourcentage de 1RM est constante d’une séance à l’autre, mais peut varier en raison de la fatigue, ce qui rend la modulation du paramètre de perte de vitesse (VL) essentielle lors des séances d’entraînement.
Planification
Lors de la planification des compétitions, la priorité est donnée à l’événement le plus important. Ce processus varie entre les sports individuels et les sports collectifs. Par exemple, une équipe de football aura une courte période hors saison et un long calendrier de compétitions, tandis qu’un sprinteur pourra diviser sa planification annuelle en deux saisons (indoor et outdoor) afin d’atteindre deux pics de forme. Dans les deux disciplines, l’entraînement alterne entre des périodes axées sur la force maximale (hors saison) et la puissance (en saison).
Programmation hors saison vs. en saison
La principale différence entre l’entraînement hors saison et en saison réside dans l’objectif principal sur lequel le programme d’entraînement doit se concentrer. Ce programme peut être modulé par la charge appliquée, le choix de la perte de vitesse qui détermine le volume de travail, et la spécificité des exercices sollicitant principalement les muscles engagés dans le geste technique de l’activité compétitive.
L’objectif principal de l’entraînement hors saison est d’augmenter la force maximale. Cependant, ce développement ne doit pas reposer uniquement sur un entraînement de type hypertrophie, car travailler jusqu’à l’échec peut accroître la fatigue résiduelle, le risque de blessure et une masse musculaire excessive (1).
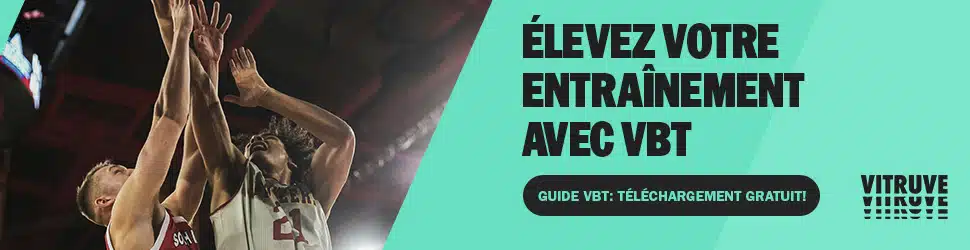
Vous ne pouvez pas savoir jusqu’où vous vous poussez si vous ne mesurez pas la perte de vitesse
Le concept de perte de vitesse (VL) est un élément crucial dans la programmation de l’entraînement. La VL représente la diminution de la vitesse d’exécution d’un exercice à mesure que l’athlète se fatigue. S’entraîner jusqu’à l’échec avec une VL supérieure à 40 % peut entraîner une fatigue résiduelle et un risque accru de blessure dans les 48 à 72 heures suivant une séance intense (2).
De plus, cette approche peut favoriser l’augmentation des unités motrices lentes au détriment des rapides, compromettant ainsi la capacité à générer de la puissance explosive (3). Il est donc essentiel de moduler la VL pour optimiser les gains de force et de puissance sans compromettre la performance et la sécurité de l’athlète.
L’utilisation de la vitesse (avec un codeur linéaire comme Vitruve) pour surveiller et guider la prescription des exercices permet d’augmenter la force maximale en réduisant le volume de travail jusqu’à 40 %, tout en améliorant l’individualisation et le contrôle des réponses à l’entraînement.
Contrairement à la méthode basée sur un pourcentage du 1RM, la méthode VBT prend en compte les fluctuations des niveaux de force maximale en surveillant la vitesse pendant l’échauffement et les séances d’entraînement. De cette manière, l’athlète ou l’entraîneur peut ajuster la charge externe pendant la séance simplement en se référant à la vitesse moyenne de la série précédente ou à la première répétition de la série suivante, garantissant ainsi que la charge reste appropriée tout au long de l’entraînement (4).
En outre, ces informations peuvent servir à déterminer la fin d’une séance d’entraînement, à indiquer la fatigue si un athlète ne parvient pas à maintenir les vitesses requises, et à permettre des schémas de séries et de répétitions flexibles ou fixes, comme s’entraîner jusqu’à une perte de vitesse de 20 %. La programmation flexible prend en compte les différents taux de fatigue, les différences entre athlètes et leur disponibilité quotidienne, améliorant ainsi la constance de la vitesse et de la puissance. Par exemple, les modèles de périodisation par blocs utilisant le VBT peuvent commencer avec des seuils de perte de vitesse de 30 %, poursuivre avec un mésocycle de force et un seuil de 20 %, puis conclure avec des seuils de 10 %, réduisant la fatigue et assurant une plus grande puissance.
Hors saison: de la détente à la puissance!
Comme les athlètes participent à diverses activités en dehors de l’entraînement de force, la gestion de la fatigue est cruciale pour les entraîneurs. En utilisant des seuils relatifs de perte de vitesse avec la méthode VBT, il est possible de contrôler l’accumulation de fatigue et d’obtenir des réponses plus homogènes parmi les athlètes.
Pendant la période hors saison, on distingue deux phases : la première avec des objectifs généraux et la seconde avec des objectifs spécifiques. La première phase vise à améliorer l’endurance et la coordination intermusculaire en utilisant des charges allant de 65 à 75 % du maximum, avec une perte de vitesse allant jusqu’à 30 % (VL30 %).
À ce stade, l’objectif principal doit être de garantir la bonne exécution des mouvements. Selon la durée de la phase générale, il est bénéfique d’incorporer une phase excentrique lente (durant jusqu’à 3 secondes) et une phase concentrique rapide (environ 1 seconde) avant de mettre en œuvre une intention maximale. Cette approche aide à renforcer les jonctions muscle-tendon, réduisant ainsi le risque de blessures. Pour les athlètes plus jeunes et moins expérimentés, la phase générale devrait être prolongée. Il est conseillé d’inclure des phases isométriques et une variété d’exercices afin de les préparer à un entraînement de coordination intramusculaire.
Coordination intramusculaire pour augmenter la force
Cet aspect de la force améliore la capacité à recruter les unités motrices, à réduire les facteurs inhibiteurs et à augmenter la fréquence de décharge des motoneurones, autant d’éléments qui contribuent à l’augmentation de la force maximale (5). Les charges doivent dépasser 75 à 80 % du maximum, et la phase concentrique doit être exécutée avec une intention maximale, conformément aux principes du VBT.
Le suivi des répétitions avec Vitruve permet de contrôler une vitesse moyenne comprise entre 0,6 et 0,4 m/s. De plus, au cours de ces semaines, la perte de vitesse ne doit pas dépasser 20 % pour les membres inférieurs et 30 % pour les membres supérieurs (VL20-VL30 %). Il faut éviter d’accumuler une fatigue résiduelle qui pourrait nuire aux entraînements sur le terrain par la suite.
Quelle est la durée de l’entraînement en force maximale?
L’entraînement en force maximale ne doit jamais être complètement interrompu, mais plutôt maintenu avec un volume réduit et moins de séries. Si la période hors saison est longue, les blocs d’entraînement en force peuvent durer jusqu’à 12 semaines. Dans le cas de périodes hors saison courtes, un minimum de 4 semaines est nécessaire pour obtenir des bénéfices significatifs (6).
Maintenir la force maximale entre la période hors saison et la saison
Avant la phase compétitive ou la saison, les programmes d’entraînement doivent intégrer un travail de puissance avec des charges adaptées aux exigences spécifiques du sport. La transition d’un mésocycle consacré à la force maximale vers un mésocycle orienté vers la puissance spécifique implique d’augmenter progressivement le nombre de séries dédiées à l’entraînement de la puissance, tout en réduisant les séries consacrées à la force maximale.
Par exemple, on peut alterner des séries de squats avec une vitesse moyenne de 0,5 à 0,4 m/s et une perte de vitesse (VL) de 20 % avec des séries affichant une vitesse moyenne de 0,8 à 1,0 m/s et une VL de 10 %, comme illustré dans la Figure 2.
Phase de transition
Pendant la période de transition entre un mésocycle axé sur la force maximale et un autre orienté vers la puissance spécifique, le nombre de séries d’entraînement de puissance doit augmenter, tandis que les séries consacrées à la force maximale doivent diminuer. Comme mentionné précédemment, l’entraînement de puissance spécifique nécessite des charges adaptées au sport pratiqué. Par exemple, un joueur de football n’a pas besoin de maintenir des charges correspondant à des vitesses comprises entre 0,8 et 1,0 m/s. Il peut plutôt se concentrer sur ce que Bryan Mann a défini comme la force-vitesse (1,0 à 1,3 m/s) et la force de départ (supérieure à 1,3 m/s).
En saison
Pendant la saison de compétition, il est crucial de maintenir les niveaux de force maximale atteints durant la période hors saison. Dans le même temps, il est essentiel de se concentrer sur l’expression de la puissance spécifique à travers des exercices balistiques et des mouvements qui imitent étroitement les gestes techniques du sport.
Pour illustrer le principe qui sous-tend cette méthode, nous faisons référence à notre courbe de puissance, qui ressemble à une courbe en cloche et présente des caractéristiques uniques, comme le montre la Figure 3.
Figure 3. Les lignes pointillées représentent les intensités d’entraînement pour la force et la puissance, ainsi que leurs valeurs de vitesse moyenne correspondantes. On observe également les décalages possibles vers le haut et vers la droite de la ligne de régression, illustrant la relation force-vitesse et la courbe de puissance indiquées.
L’entraînement avec la méthode de contraste, introduite initialement dans l’athlétisme par Gilles Cometti sous le nom de Méthode Française de Contraste, consiste à alterner, au sein d’une même séance, des séries avec charges lourdes et des séries avec charges légères. Les séries avec charges lourdes doivent représenter plus de 80 % du 1RM, avec une vitesse moyenne d’environ 0,4 m/s (comme indiqué dans la Figure 3). Selon les principes du VBT en saison, un seuil de perte de vitesse de 10 % ne doit pas être dépassé lors de ces séries.
Les séries lourdes doivent être alternées avec des séries légères conçues spécifiquement pour développer la puissance explosive, en utilisant des charges de 20 à 30 % du 1RM (selon le type de puissance à stimuler), ainsi que des exercices pliométriques, avec une vitesse moyenne supérieure à 1,3 m/s. Pour les exercices de « puissance », il est recommandé d’éviter une diminution de vitesse supérieure à 10 % au sein d’une série dans la plupart des cas. Cependant, lors des phases de pic de performance ou de tapering, un seuil de 5 % peut être plus approprié (2,7).
À mesure que l’on progresse vers des compétitions plus importantes, il est nécessaire d’augmenter le nombre de séries de puissance et de vitesse au détriment des séries de force maximale. Cette approche permet de transférer le travail de force maximale réalisé pendant la période hors saison vers la puissance, en déplaçant la courbe de puissance vers le haut et vers la droite, sans perte excessive des niveaux de force maximale.
Il est important de souligner que l’entraînement balistique, y compris la méthode pliométrique, ne peut pas être introduit soudainement pendant la saison de compétition. Il doit plutôt être planifié sous une forme légère dès la phase générale de la période hors saison. Dans un premier temps, il convient d’augmenter les volumes, puis l’intensité. Au fur et à mesure que la période hors saison avance, on établit les prérequis pour un travail pliométrique de haute intensité et de faible volume.
Conclusion
En conclusion, voici un exemple de périodisation et de programmation pour une saison en salle (par exemple, pour un sprinteur), conçu pour vous aider à comprendre, appliquer et personnaliser l’entraînement hors saison et en saison en utilisant la méthode VBT.
Références
1 Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). Periodization-: theory and methodology of training. Human kinetics.
2 Sánchez-Medina L, González-Badillo JJ. Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. Med Sci Sports Exerc. 2011 Sep;43(9):1725-34. doi: 10.1249/MSS.0b013e318213f880. PMID: 21311352
3 Pareja-Blanco F, Rodríguez-Rosell D, Sánchez-Medina L, Ribas-Serna J, López-López C, Mora-Custodio R, Yáñez-García JM, González-Badillo JJ. Acute and delayed response to resistance exercise leading or not leading to muscle failure. Clin Physiol Funct Imaging. 2017 Nov;37(6):630-639. doi: 10.1111/cpf.12348. Epub 2016 Mar 11. PMID: 26970332.
4 González-Badillo JJ, Yañez-García JM, Mora-Custodio R, Rodríguez-Rosell D. Velocity Loss as a Variable for Monitoring Resistance Exercise. Int J Sports Med. 2017 Mar;38(3):217-225. doi: 10.1055/s-0042-120324. Epub 2017 Feb 13. PMID: 28192832.
5 Suchomel TJ, Nimphius S, Stone MH. The Importance of Muscular Strength in Athletic Performance. Sports Med. 2016 Oct;46(10):1419-49. doi: 10.1007/s40279-016-0486-0. PMID: 26838985.
6 Del Vecchio A, Casolo A, Negro F, Scorcelletti M, Bazzucchi I, Enoka R, Felici F, Farina D. The increase in muscle force after 4 weeks of strength training is mediated by adaptations in motor unit recruitment and rate coding. J Physiol. 2019 Apr;597(7):1873-1887. doi: 10.1113/JP277250. Epub 2019 Feb 6. PMID: 30727028; PMCID: PMC6441907.
7 Sekulović, V., Jezdimirović-Stojanović, T., Andrić, N., Elizondo-Donado, A., Martin, D., Mikić, M., & Stojanović, M. D. M. (2024). Effects of In-Season Velocity-Based vs. Traditional Resistance Training in Elite Youth Male Soccer Players. Applied Sciences, 14(20), 9192. https://doi.org/10.3390/app14209192